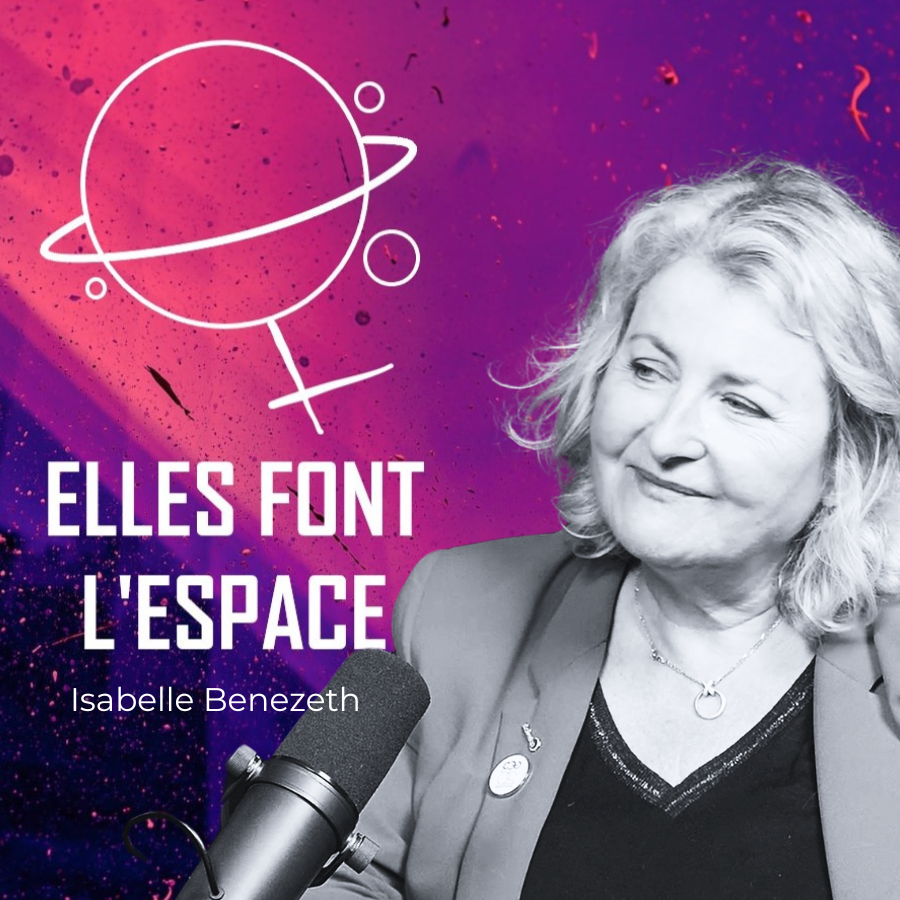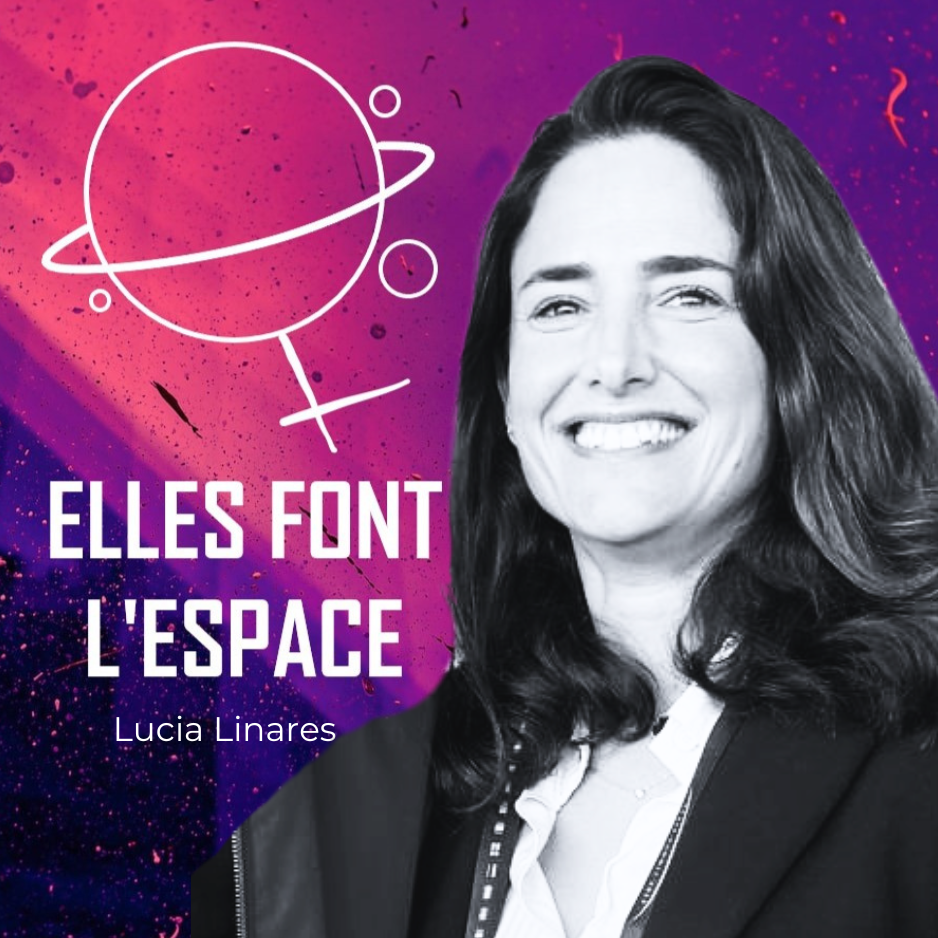Episode Transcript
[00:00:00] Speaker A: Copernicus gêne énormément les États-Unis. Pourquoi ? Parce que quand on veut ne rien faire pour un phénomène, on a intérêt à le nier, même si on sait parfaitement qu'il existe. Donc, je pense qu'ils sont plutôt dans cette posture-là maintenant, parce qu'il y a eu un temps où on pouvait douter, où on pouvait... Là, aujourd'hui, les gens qui disent qu'ils doutent, ils mentent.
[00:00:22] Speaker B: Pour toi, c'est indéniable.
[00:00:23] Speaker A: Pour moi, c'est indéniable, oui.
[00:00:27] Speaker B: Dans cet épisode de Elle font l'espace, je reçois Isabelle Benezet. Isabelle est coordinatrice interministérielle au ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur pour les programmes Spatio Copernicus et Géo. Avec Isabelle, on parle de spatial, on parle de coopération internationale, beaucoup évidemment de changement climatique et pas mal non plus de Donald Trump. Bonjour Isabelle.
[00:00:57] Speaker A: Bonjour Gilles.
[00:00:58] Speaker B: Merci d'être avec nous déjà aujourd'hui, de venir nous voir dans le studio. Est-ce que je peux te demander de nous décrire ton job, ta fonction de manière simple ?
[00:01:11] Speaker A: Je suis coordinatrice interministérielle de Copernicus et j'anime aussi la communauté du groupe Honors Observation de GEO, mais ma fonction principale c'est Copernicus. Je suis rattachée au ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur. Et mon travail, c'est de coordonner les différents points de vue et les différentes parties qui participent, qui contribuent à Copernicus ou qui utilisent Copernicus au niveau de la France et de porter la position française au niveau des instances européennes.
[00:01:45] Speaker B: Et Copernicus, c'est le programme de satellite européen d'observation de la Terre.
[00:01:51] Speaker A: Alors, c'est le programme de surveillance de la Terre, avec d'abord des services, des services de surveillance de la Terre, de l'océan, du territoire, de la qualité de l'air. Il y en a six. Et pour ces services, on a développé une composante spatiale, en effet, avec des satellites. Et donc, en tout, on a douze sentinelles différentes qui sont soit opérationnelles, soit en cours de lettre.
[00:02:18] Speaker B: Et qu'est-ce que la surveillance de la Terre ? Toi, tu appelles ça surveillance de la Terre ? On peut en parler un petit peu ? Moi, j'appelle ça observation de la Terre. C'est quoi la différence ?
[00:02:25] Speaker A: L'observation de la Terre, tu te contentes de faire une photo de la situation et tu t'arrêtes là. Tandis que la surveillance de la Terre, c'est aussi anticiper ce qui va se produire. Donc, on fait, dans le cadre de Copernicus, on fait des prévisions. On fait des prévisions d'océanographie, on fait des prévisions de qualité de l'air qui sont utilisées de façon opérationnelle par l'État français, par exemple.
[00:02:47] Speaker B: On comprend bien. On connaît tous la météo. La météo, ce sont des prévisions. Vous faites la même chose sur la santé de la Terre, finalement.
[00:02:55] Speaker A: Exactement. Vraiment, l'analogie avec la météo, elle est très bien trouvée et bien choisie parce que c'est exactement la même chose. On observe, on mesure par satellite ou par in situ au sol et on fait des modèles pour prévoir.
[00:03:12] Speaker B: Et aujourd'hui, on ne peut pas parler de la santé de la Terre sans parler de la crise climatique. Bien sûr, c'est le gros enjeu du XXIe siècle. Enfin, un des gros enjeux en tout cas. Qu'est-ce que concrètement la surveillance de la Terre apporte à la résolution d'une crise climatique ou en tout cas au combat dans cette crise ?
[00:03:33] Speaker A: Alors déjà, le fait d'observer et d'avoir des observations à long terme, ça permet d'avoir une vérification que ce qu'on dit est vrai. Et donc le changement climatique est une réalité qu'on peut observer. Et ça, on a des données spatiales qui sont les données météo, qui datent des années 80. Et puis des observations au sol qui sont bien plus anciennes. Et grâce à ces observations, plus à la recherche, on reconstitue le climat passé et on arrive à avoir une évolution de l'ensemble de la Terre, de l'atmosphère, au travers du temps. Et à partir de là, on voit bien le réchauffement, il devient évident. On a même des changements de type de temps. La température augmente. Il y a énormément de La température qui augmente, c'est vraiment qu'un petit effet du changement climatique. Il y en a bien d'autres qui vont nous gêner peut-être encore davantage que la température qui augmente. Par exemple ? Par exemple, la montée des niveaux de l'eau, qui au départ, il y a 20 ans, montait de 2 millimètres par an. Maintenant, c'est plutôt 4 à 5 millimètres par an. Et ça a tendance à augmenter au fil du temps. J'ai une bonne amie qui me disait que le changement climatique, c'est comme une pierre qui roule sur une pente. Au début, on ne voit pas grand-chose. Et puis, quand elle est lancée, on ne peut plus l'arrêter.
[00:05:07] Speaker B: Et c'est de plus en plus rapide.
Ce genre de prévision faite par Copernicus, tu parles de vérification de ce qu'on avance, mais aussi de prévision. Vous prévoyez des crises annexes à la crise climatique ?
[00:05:29] Speaker A: Alors pour le climat, on ne fait pas vraiment de prévision sur Copernicus parce qu'il y a énormément de simulations qui sont faites pour le GIEC et donc on les utilise en fait. On utilise les simulations du GIEC, on utilise aussi les descentes d'échelle qui sont faites au niveau européen et de façon à avoir... On a des prévisions qui sont validées par les scientifiques mondiaux.
[00:05:53] Speaker B: De la même manière que ces scientifiques-là, du GIEC, utilisent eux les données des satellites pour faire leur rapport ?
[00:06:00] Speaker A: Oui, tout à fait. Ils les utilisent sur le long terme et ils les utilisent à plus court terme aussi parfois, notamment pour constater l'état des eaux, la montée des eaux, la température des sols, et puis l'hydrologie aussi, les précipitations.
[00:06:18] Speaker B: Et justement, quand tu parles de vérification de ce qu'on avance, on est dans un contexte géopolitique qu'on ne peut pas ignorer, où il y a de plus en plus de crédibilité apportée par des politiques aux États-Unis pour des gens qui nient cette évidence de la crise climatique. Clairement, on va parler de Trump, qui prend des actions assez drastiques. Qu'est-ce que ça a à voir, Copernicus, dans ce contexte géopolitique-là ?
[00:06:51] Speaker A: Alors, Copernicus gêne énormément les États-Unis. Pourquoi ? Parce que quand on veut ne rien faire pour un phénomène, on a intérêt à le nier, même si on sait parfaitement qu'il existe. Donc, je pense qu'ils sont plutôt dans cette posture-là maintenant, parce qu'il y a eu un temps où on pouvait douter, où on pouvait... Là, aujourd'hui, les gens qui disent qu'ils doutent, ils mentent.
[00:07:13] Speaker B: Pour toi, c'est indéniable.
[00:07:15] Speaker A: Pour moi, c'est indéniable, oui. Et tous les gens qui agissent au niveau politique ne peuvent pas le savoir. Ils sont en contact avec les scientifiques, ils le savent. Ils ne veulent rien faire, donc ils n'ont pas du tout intérêt à ce que les gens soient au courant que le climat change. Donc, ils ont intérêt à dire, il ne se passe rien. Je ne sais pas si tu as vu le film « Don't Look Up » sur Netflix.
[00:07:36] Speaker B: « Don't Look Up », bien sûr, oui.
[00:07:38] Speaker A: Eh bien, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on nie l'évidence pour que les gens soient tranquilles, qu'ils ne s'angoissent pas, qu'ils n'aillent pas protester, manifester, etc. On ne fait rien, mais soi-même, au fond, on a un plan B, je pense.
[00:07:54] Speaker B: Et le plan B, c'est quoi, du coup ?
[00:07:55] Speaker A: Je ne sais pas, je ne suis pas dans la tête de Trump, mais je pense qu'ils pensent que ces gens pensent que leur argent va leur permettre d'échapper aux conséquences négatives. Je ne sais pas, peut-être qu'ils vivront sous un dôme de verre, peut-être. Dans Don't Look Up, ils quittent la Terre au moment où tout explose. Ils ont, je pense, un plan B. Ils ont un plan B et lequel, lequel, je ne sais pas.
[00:08:22] Speaker B: Et dans cette forme de déni, il y a même des actions qui nous inquiètent beaucoup, des menaces de suppression de données, par exemple.
[00:08:32] Speaker A: Oui, ce n'est pas des menaces. Ah non, ce n'est pas des menaces. Ils ont déjà supprimé... Déjà, le premier mandat de Trump, il avait supprimé des bases de données. C'est très facile, il suffit d'arrêter de financer le maintien opérationnel de ces bases de données. Et puis, ça y est, les données disparaissent. Donc, il y a quand même une grande solidarité entre scientifiques et qui savent très bien que les données, elles sont vitales. C'est-à-dire que les données des États-Unis, elles sont vitales aussi pour nous. Et donc, on essaie d'en récupérer une grande partie. À une époque, le Centre européen de prévision de météo avait récupéré beaucoup de données qui venaient de la NOA, notamment, et qui étaient menacées par Trump à la demande des scientifiques américains.
[00:09:17] Speaker B: Et la NOA a été encore menacée sur le mandat de Trump 2.
[00:09:21] Speaker A: Plus que menacés, il y a eu des suppressions de postes terribles. Leur star sur la recherche du climat a été licenciée. C'est quand même énorme. C'est quand même énorme parce qu'ils se tirent une balle dans le pied pour les dix ans qui viennent.
[00:09:38] Speaker B: Tu peux rappeler ce que fait la NOAA aux Etats-Unis, par exemple, pour ceux qui ne connaissent pas ?
[00:09:41] Speaker A: La NOAA, à la fois, c'est la météo et l'océanographie aux Etats-Unis. C'est Météo France plus Mercator Océan ou l'IFREMER.
[00:09:52] Speaker B: D'un côté, ça nous montre la pertinence d'avoir des données indépendantes, autonomes, qui nous appartiennent à nous et qui ne sont pas menacées de fait par des chefs d'État étrangers qui auraient des velléités politiques spécifiques. Mais je pense aussi à ce que ça nous apprend de ce qu'on prend pour acquis chez nous.
et qui peut-être n'est pas aussi évident que ça. Ça t'inspire quoi quand tu vois au XXIe siècle ce genre de comportement dans ce que ça pourrait donner chez nous par exemple ?
[00:10:28] Speaker A: Il faut considérer qu'aucun droit n'est acquis jamais. Je crois que c'est un concept de base. C'est vrai qu'on vit confortablement dans un pays libre, on dit ce qu'on veut, on pense ce qu'on veut. Et je crois qu'il faut considérer que c'est précieux et que ce n'est pas acquis. Et donc, il faut y penser à chaque fois qu'on vote, en fait. Je crois que c'est crucial. Et de se dire que la démocratie, elle peut être mise en danger aussi. qu'elle n'est pas... Il suffit d'élire... Dans l'histoire, tous les tyrans, à un moment donné, au début, ils ont été élus.
[00:11:10] Speaker B: Ce que tu es en train de dire, c'est que les données satellitaires sur le climat, sur la Terre, sont finalement un peu une épine dans le pied d'autocrates et de gens qui veulent nous raconter des histoires qui ne correspondent pas à la réalité.
[00:11:26] Speaker A: Surtout Copernicus, parce que les données sont libres et ouvertes. Tout le monde peut les avoir gratuitement. Et oui, oui. D'ailleurs, moi, je vois bien, dans le cadre de GEO, on travaille énormément avec des données ouvertes. Et Copernicus gêne énormément les Américains, parce qu'avant Copernicus, c'étaient eux les rois du monde avec l'insat. Et c'est eux qui faisaient la pluie et le beau temps avec leur programme Landsat qui était ouvert. Et aujourd'hui, les budgets de Landsat sont plus que menacés. En tout cas, les propositions de budget sont des revues à la baisse, très largement.
[00:12:00] Speaker B: Tandis que Copernicus reste le programme d'observation de la Terre, de surveillance de la Terre le plus le plus grand monde, tu dirais ?
[00:12:08] Speaker A: Oui. En tout cas, celui qui est ouvert, c'est le seul et l'unique qui est... Alors maintenant, il y a d'autres programmes d'observation de la Terre, mais qui ne sont pas partagés, qui sont fermés, qu'on connaît que parce qu'on fait de l'intelligence économique. Mais notamment la Chine a développé son propre programme en s'inspirant de Copernicus, qui ne partage absolument pas. Et ce qui est intéressant dans Copernicus, c'est le fait qu'il soit ouvert Et.
[00:12:36] Speaker B: Ça, c'est important pour la France, parce que toi, tu représentes la position française à l'Union européenne. Donc, c'est important pour la France que ces données-là soient ouvertes ?
[00:12:45] Speaker A: Oui, c'est important pour la France aussi. C'est important, évidemment, pour l'Union européenne. Il y a un commissaire, une fois, qui a dit que Copernicus était le phare de l'Europe sur le monde. Et oui, c'est le phare de l'Europe sur le monde, parce que ça donne les moyens à des gens qui sont moins favorisés que nous, qui ont moins de connaissances que nous, de profiter de la connaissance qui est dans Copernicus et qui est mise à la disposition de tous. Et la France s'en sert au niveau diplomatique parce que c'est quand même un atout. Et dans les négociations, c'est hyper important d'avoir des données ouvertes. Après la COP21, j'avais discuté ce qu'on pensait mettre en place dans Copernicus, un système de surveillance des émissions anthropiques de CO2, donc des émissions humaines, ce qui n'existe pas pour le moment. Et donc là, on est sur le point de lancer des satellites qui vont le faire. Donc, ce sera une première mondiale. Et ça, quand on a... Les négociateurs nous ont dit quand on dit ça, c'est-à-dire quand on annonce aux gens que, attention, d'ici peu de temps, on sera en mesure de vérifier ce que vous dites.
[00:13:56] Speaker B: Et ça, c'est du soft power finalement.
[00:13:57] Speaker A: Exactement. Ça change l'attitude complètement des négociations.
[00:14:02] Speaker B: C'est dingue parce que moi, j'ai l'habitude de travailler avec le vol habité, l'exploration humaine de l'espace. Le fait que le vol habité soit du soft power pour les États, c'est quelque chose qu'on connaît très bien depuis les programmes Apollo, etc. Mais j'avais pas pensé, j'avais pas imaginé que l'observation de la Terre en tant que programme spatial puisse aussi être considérée comme du soft power.
[00:14:27] Speaker A: Ah oui, et même un surf power puissant. D'abord parce que Copernicus c'est la référence aujourd'hui. Il n'y a pas un programme de recherche qui utilise du spatial qui n'utilise pas Copernicus, au moins, enfin pas seulement, parce que les données elles font plutôt du 12 mètres que du 1,50 mètre. Mais avec ça déjà, avec la revisite qu'on a, on fait énormément de choses. Et si, quand on s'aperçoit qu'il faut plus, on va chercher plus. Mais du coup, on n'est pas obligé d'acheter en masse des données. Et du coup, même des gens qui ont assez peu de moyens pour faire leur recherche, ils peuvent la faire. Et le fait que ce soit nos données à nous qui sont utilisées dans presque tous les programmes de recherche, franchement, ça gêne énormément de gens. Il faut se battre pour que dans les textes, il y ait une référence à Copernicus. Et je trouve que c'est assez éclairant de voir que les Américains font tout pour faire disparaître Copernicus.
Parce que vraiment, c'est l'Europe qu'il décrit, l'Europe qui, pour eux, est vieille et lente, etc.
[00:15:35] Speaker B: C'est l'Europe que déteste Trump, finalement.
[00:15:37] Speaker A: Oui, mais en même temps, c'est l'Europe qui le gêne énormément, parce qu'il met aux yeux de tout le monde la réalité des faits, qui donne les moyens aux gens de se développer sans qu'on leur fasse croire qu'ils doivent acheter des données qui valent une fortune, alors que les données, ils les ont. C'est la science européenne qui est partagée et qui rayonne.
Je pense qu'on ne le voit pas assez, on n'en parle pas assez, cette importance qu'a Copernicus au niveau même des négociations. C'est considéré aussi comme un acquis, c'est comme quelque chose qu'on donne. Et l'Union européenne, d'ailleurs, en a pris la mesure et maintenant a un programme pour soutenir le développement de Copernicus dans le monde, en fait, et l'utilisation.
[00:16:29] Speaker B: Ça, ça m'intéresse quand tu parles des négociations. Comment concrètement on utilise Copernicus dans des négociations politiques aujourd'hui. Est-ce que tu peux me donner un exemple ?
[00:16:41] Speaker A: Alors, moi je te parle des négociations d'accords internationaux. Le fait, si tu veux, de dire aux gens, d'ici deux ans, et là on aura peut-être des éléments mais qui ne seront pas encore Tu sais, l'Accord de Paris prévoit tous les 6 ou 8 ans une évaluation globale. Ils appellent ça le Global Stocktake du CO2 et des gaz à effet de serre. Et en fait, Copernicus, quand on aura lancé nos satellites et que le système, le service associé sera développé, on pourra avoir une espèce d'évaluation objective des déclarations des États. Parce que pour l'instant, ces évaluations sont faites sur la déclaration des États.
Alors, en Europe, elles sont fiables parce qu'on ne triche pas et on a des moyens de calcul qui sont très précis. Donc, pour nous-mêmes, on n'en a pas franchement besoin. Mais être exposé, tous les problèmes environnementaux, c'est la même chose. Exposer le contrevenant, ça l'aide à s'améliorer, on va dire.
[00:17:51] Speaker B: Quand tu dis ça, je me dis, ok, donc ça gêne les États-Unis, bon, très bien, on est souverains ici, on peut continuer à financer ce genre de recherches, ce genre de programmes, etc. Mais on a aussi, chez nous, peut-être des gens que ça dérange. Je pense à des industriels ou des gens que ça pourrait aussi déranger que la vérité soit, tu vois, mise à jour et puis partagée avec tout le monde. C'est le cas ou je me trompe ?
[00:18:17] Speaker A: Alors oui, oui, d'une certaine façon, mais je pense qu'on a un peu dépassé ça quand même grâce à l'Union européenne, parce qu'on a des directives qui sont assez strictes, qui sont des directives environnementales, qui sont contrôlées notamment maintenant par Copernicus et qui vont l'être de plus en plus. C'est-à-dire qu'on va utiliser le spatial pour vérifier que les États respectent leurs engagements.
Alors oui, il y a un côté contrôle qui n'est pas très forcément agréable, mais je dirais qu'on a plus d'intérêt industriel à le faire plutôt qu'à ne pas le faire.
[00:18:50] Speaker B: Tu penses que culturellement, on a dépassé ça grâce au côté un peu indéniable et incontestable des données, justement ?
[00:19:00] Speaker A: Alors, il y a ça et oui, et puis le travail qu'a fait l'Union européenne depuis longtemps. Je crois qu'on doit beaucoup, de ce point de vue, on ne le dit pas assez, mais on critique beaucoup l'Union européenne. Mais l'Union européenne a fait beaucoup pour l'environnement et pour qu'on vive dans des conditions plus sûres et pour protéger la planète. Donc, c'est un des très bons côtés de l'Union européenne.
[00:19:29] Speaker B: Tant mieux. Tu parlais d'utilisation des données tout à l'heure et du fait qu'elles soient ouvertes à tous. Je l'ignorais complètement, mais en préparant cet entretien avec toi, j'ai découvert quelque chose qui s'appelle AppliSat. Tu peux m'en parler un tout petit peu parce que j'ai l'impression que c'est une appli que tout le monde peut avoir sur son téléphone pour l'utiliser. C'est peut-être pas tout à fait ça.
[00:19:52] Speaker A: C'est un service web, en tout cas, qui permet... Alors, ça a été mis en place par le ministère de la Transition écologique. Et ce qui est intéressant, c'est que le ministère de la Transition écologique représente quasiment tous les utilisateurs publics de Copernicus. D'ailleurs, c'est eux qui animent le côté, le user forum de Copernicus. C'est eux qui sont délégués. C'est le ministère de la Transition écologique parce que tous les organismes qui utilisent Copernicus Ils dépendent du ministère de la Transition écologique. Enfin, pas tous, mais presque. Et donc, AppliSat, c'est une initiative pour aider justement les utilisateurs publics et non publics à utiliser les données de Copernicus, mais aussi les données d'observation de la Terre qui sont disponibles.
[00:20:43] Speaker B: C'est qui ces utilisateurs typiquement ?
[00:20:46] Speaker A: Les communautés urbaines, par exemple, qui peuvent avoir besoin d'utiliser Copernicus pour telle ou telle chose, ou les parties du ministère qui font, par exemple, la surveillance maritime. Ils utilisent Copernicus parce qu'il y a un service qui leur produit de l'aide pour surveiller, par exemple, les pêches. La pêche, d'accord.
[00:21:13] Speaker B: Moi je viens d'une famille d'agriculteurs, donc est-ce que c'est... est-ce que si je suis agriculteur, je peux utiliser un truc comme ça pour, je sais pas, améliorer mon rendement quotidien ou...
[00:21:25] Speaker A: Alors oui, il y a des applications, mais elles sont plutôt du domaine privé. On ne va pas jusque-là sur Copernicus. Mais effectivement, grâce à Copernicus, on peut développer ces applications. Et Airbus Service fait ça, par exemple. Ils montrent ça aux coopératives qui peuvent.
[00:21:42] Speaker B: Après... OK, et donc cette appli, AppliSat, ce programme AppliSat, finalement, il intervient dans beaucoup, beaucoup de domaines, j'ai l'impression.
[00:21:52] Speaker A: Alors oui, c'est un site web qui a été mis en place par le ministère de la Transition écologique et le CRMA, et qui effectivement couvre l'ensemble des thématiques du ministère, qui sont extrêmement larges, qui servent d'appui aux politiques publiques et notamment aux communautés urbaines. qui ont besoin parfois de cas d'usage pour essayer de se repérer, pour voir ce qu'ils peuvent faire avec les données spatiales. Et donc ça va des sargasses qui sont en ce moment en cours, aussi à l'occupation des sols et l'identification des friches. ou la végétalisation en ville. Les catastrophes naturelles aussi. Il y a énormément de sujets qui sont traités dans ce cadre-là et qui peuvent permettre aux communautés urbaines de développer des applications qui répondent à leurs besoins.
[00:22:47] Speaker B: Ça permet finalement de créer un pont entre le local et les données des satellites, la big data qui vient des satellites d'observation de la Terre.
[00:22:57] Speaker A: Tout à fait, en mettant autour de l'expertise pour que les gens puissent se repérer, quoi. C'est un petit peu une boussole.
[00:23:06] Speaker B: Ouais, je vois. Parce que c'est dingue, tu disais tout à l'heure, on a six types de satellites différents, six types de sentinelles différents avec A, B, C... Douze. Pardon.
[00:23:16] Speaker A: Non mais en vol, on n'en a... Tu as dit 6. Oui. Non, non, j'ai dit 10. J'ai dit 6. Oui, parce que c'est 6 qui sont la première génération.
[00:23:24] Speaker B: C'est ça.
[00:23:24] Speaker A: On en a 6 autres en préparation, de type de satellite.
[00:23:27] Speaker B: OK. Donc aujourd'hui, on a en vol 6 types de satellites. C'est ça ?
[00:23:32] Speaker A: Pas encore. Pas encore. Si tu veux, Copernicus...
[00:23:35] Speaker B: Le 6A va être lancé.
[00:23:37] Speaker A: Alors, on a huit satellites en vol, mais on a là en juillet et août, on va lancer le premier exemplaire du Sentinel-4 et du Sentinel-5, qui sont des instruments qui concernent la qualité de l'air et qui vont voler sur les satellites météo en fait, sur MétéoSat et sur Métop. Et puis on va lancer un Sentinel-6 à la fin de l'année.
[00:24:01] Speaker B: Voilà, ça je l'ai vu ce matin, tu vois.
Donc on a un certain nombre de satellites dans l'espace, et avec ces satellites d'observation de la Terre, on arrive à développer des applications dans des domaines très divers finalement.
[00:24:19] Speaker A: Oui, mais si tu veux, tu as aussi intérêt à utiliser les services. Ces services sont là pour ça. Ils sont là pour mâcher un petit peu le travail entre la donnée spatiale et l'utilisateur. Et aujourd'hui, quand on discute avec les PME, ils disent qu'ils préfèrent prendre les produits qui sortent des services et pour construire à partir de là. parce que les produits et services, ils sont ouverts et gratuits. Donc, si on se positionne sur le même créneau, de toute façon, on a un voilà. Et ce qu'il faut, c'est aller après un peu plus loin.
[00:24:50] Speaker B: Oui, parce que ce n'est pas ouvert à tous. Enfin, c'est ouvert à tous, mais ce n'est pas accessible à tous d'utiliser les données brutes et satellites pour aider, que ce soit dans son business ou dans son travail de collectivité, par exemple.
[00:25:09] Speaker A: Oui, mais tu vois, les collectivités urbaines, avant, ils utilisaient pas mal de bureaux d'études, parce que justement, les données, elles étaient quand même assez brutes. Mais maintenant, autour de ces données brutes, il y a quand même un ensemble de services qui sont proposés. Alors, le CNES a mis en place un système qui s'appelle GEOD, qui permet d'accéder aux données Copernicus avec et des services autour. Plus les données de leur système data terrain qu'un système de recherche de données spatiales. Et puis, ils ont mis en place ConnectBackness. Ils ont un ensemble de services pour aider les gens à se développer. Et pareil, Copernicus, au niveau européen, a fait le Copernicus Data Space Ecosystem, le CDSE. qui apparaît accessible gratuitement en ligne. Et on peut faire beaucoup, beaucoup de choses avec ce CDSE. Donc, il y a des aides aujourd'hui, vraiment. Je ne dis pas que Monsieur Tout-le-Monde peut le faire, mais en tout cas, une communauté urbaine d'assez bonne taille qui a un ingénieur peut se débrouiller.
en se faisant aider par le CNES, en se faisant aider par le MTE et par AppliSat. Il y a plein de possibilités. Et AppliSat fait aussi des formations. Ça, on ne l'a pas évoqué, mais...
[00:26:30] Speaker B: D'accord, donc il y a vraiment un pont direct entre le citoyen, finalement, et le satellite, par ce genre d'application.
[00:26:39] Speaker A: Oui, et via aussi les services. Il y a ce pont aussi via les services de Copernicus, qui sont très importants dans le système.
[00:26:48] Speaker B: Et ce qui m'intéresse, c'est ce rôle que tu as de coordonner, on en parlait déjà, la science, les scientifiques, le politique de manière générale, en tout cas la pensée et l'action politique. Pour toi, c'est quoi les enjeux majeurs aujourd'hui comment on prend des données scientifiques et on les transforme en décisions politiques, allez, j'ai envie de dire, justes ou efficaces. Est-ce que ça fait partie des défis que tu as, toi, au quotidien ?
[00:27:25] Speaker A: Alors non, ça ne fait pas partie des défis que j'ai au quotidien parce que c'est... Comment dire ? Il y a vraiment une... un univers entre le politique et le scientifique, on va dire, et la science. D'abord, il y a un univers de temporalité. C'est-à-dire que pour un scientifique, quand tu imagines que tu as une question de recherche et que tu commences à travailler dessus, tu en as pour dix ans. C'est un peu pareil sur Copernicus. Quand tu imagines un sentinelle avant qu'il soit en l'air et utilisé, il y en a pour une dizaine d'années. Donc, ce n'est pas du tout l'échelle de pensée de temps du politique. Le politique, lui, il veut des actions tout de suite. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est évaluer l'effet des politiques publiques. Ça, on peut le faire et même le simuler avant qu'elles soient faites. Il y a un ensemble d'outils dans le programme qui permet de faire ça, notamment sur la qualité de l'air, qui permet de voir comment on peut évaluer une politique publique avant qu'elle soit mise en place. histoire de ne pas embêter les citoyens pour rien, en mettant des contraintes alors que ça n'a pas d'effet.
[00:28:31] Speaker B: Et justement, toi, tu es en prise directe avec le politique.
[00:28:35] Speaker A: Oui et non. Oui, oui, d'une certaine façon, oui, mais c'est plus compliqué que ça. Parce que si tu veux, Copernicus va prendre... Il y a les territoires, il y a l'océanographie. Quelqu'un qui veut quelque chose sur l'océan, il va s'adresser plutôt au service du MTE qui s'occupe de l'océan. Il ne va pas s'adresser directement à moi. Et d'ailleurs, ce n'est pas forcément un mal, parce que moi, je ne suis pas experte en tout.
[00:29:00] Speaker B: Bien sûr.
[00:29:01] Speaker A: Tu vois ? Et donc, ce qu'il faut, moi, mon travail, c'est de faire en sorte que la connaissance qui est disponible sur Copernicus soit accessible à tous les acteurs qui sont en lien avec les politiques publiques. Tu vois ?
[00:29:13] Speaker B: D'accord.
[00:29:14] Speaker A: C'est plutôt ce rôle-là, parce que sinon, je serais l'interlocuteur pour tout, pour tout le monde. Ce ne serait pas possible.
[00:29:22] Speaker B: Finalement, le but du jeu de Copernicus, c'est bien de faire prendre aux politiques des décisions justes grâce à la science.
[00:29:33] Speaker A: Oui, d'une certaine façon, oui.
[00:29:36] Speaker B: C'est ça, finalement. Tu parlais tout à l'heure très bien du côté implacable des données scientifiques.
qui ont vocation à faire prendre en politique des décisions qui s'imposent ou mentir. En gros, tu l'as bien décrit comme ça, il y avait deux alternatives en gros. Soit on fait ce qu'il faut faire, soit on est dans le déni total et on ment de manière assez évidente. Donc Copernicus, tu le décris comme le phare européen dans le monde.
J'imagine que c'est un programme qui a ses défis comme tous les programmes spatiaux et tous les programmes internationaux. C'est quoi pour toi les défis de Copernicus aujourd'hui ?
[00:30:22] Speaker A: Alors les défis à court terme, je dirais déjà c'est de se rendre opérationnel complètement puisqu'on a 12 sentinelles différents qui sont dans les tuyaux et en vol, pour l'instant, on en a 4-5.
[00:30:40] Speaker B: Les Sentinels, ce sont les satellites qui forment le réseau Copernicus ?
[00:30:46] Speaker A: Oui, les satellites ou les instruments.
C'est-à-dire qu'on peut avoir une sentinelle, ça peut être aussi un instrument qui est emporté sur un autre satellite. Donc vraiment, il y a un défi de rendre le système opérationnel et d'assurer sa continuité. Parce que vraiment, la continuité des observations, c'est la première priorité de tous les utilisateurs, y compris la recherche.
Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai saisi grâce aux chercheurs, parce qu'ils nous ont dit, lors d'une conférence, ils me disent, j'ai observé ce lac au milieu de nulle part. C'était un lac immense qui s'était formé sous un glacier qui avait fondu. Et tout d'un coup, le glacier avait cédé et le lac s'était déversé dans la vallée. Et par chance, c'était un endroit complètement isolé, donc il n'y avait pas eu de problème. Mais il me dit, tu vois, j'observe ça, and so what ? Je ne peux rien en faire. Je dis, comment ça, tu ne peux rien en faire ? Tu sais déjà ? Oui, parce que je ne sais pas si ça se reproduit. Je ne sais pas dans quelles conditions ça se reproduit et je ne pourrai jamais le savoir. Donc, cette observation, elle ne me sert à rien. Ce qui me sert, c'est d'avoir la continuité des observations, puisque je puisse repérer dans quelles conditions cet événement se produit et comment je peux je peux le définir et le prévoir après, l'anticiper. Et c'est vraiment la continuité des observations, c'est la priorité pour tous les utilisateurs, tous.
[00:32:18] Speaker B: La continuité pour toi, c'est le défi principal de Copernicus aujourd'hui.
[00:32:22] Speaker A: Alors, la continuité avec un peu d'amélioration, bien sûr. Mais oui, c'est un des défis principaux parce que c'est nécessaire, parce que ce n'est pas sexy.
Vous voyez, les politiques, ils aiment bien qu'on fasse un nouveau satellite. Démarrer les choses. Exactement. Et d'ailleurs, Copernicus, c'est un gros bateau, donc on prévoit ce qu'on fait très longtemps à l'avance.
[00:32:50] Speaker B: Ça, c'est un autre enjeu qui ne doit pas être évident. Les politiques, on le sait, en Europe, ils sont élus tous les 4 à 7 ans, en gros. Donc c'est relativement court-termiste par rapport à l'échelle de temps que tu présentais tout à l'heure. Comment on fait pour convaincre des politiques de s'enléger là-dedans alors que ça ne va pas forcément leur apporter des voix directement ?
[00:33:15] Speaker A: Disons qu'une fois que c'est lancé, c'est difficile à arrêter. C'est difficile à arrêter parce que maintenant, au niveau mondial, tout le monde utilise le programme, que même les PME, ils tiennent aussi énormément. Et eux aussi, ils ont besoin de continuité parce qu'ils ne peuvent pas vendre un produit ou investir sur la création d'un produit s'ils ne savent pas combien de temps ça va durer, combien de temps ils vont avoir les données. Donc, en fait, il y a une espèce de consensus un peu sociétal qui s'est créé autour de ces données, ce qui fait que c'est difficile d'arrêter ça. Maintenant, c'est difficile aussi de leur donner des annonces à faire tous les quatre ans. Et quand ils n'ont pas d'annonce, pour eux, c'est plus prioritaire. Donc, s'il y a des sacrifices à faire, on les fait plutôt du côté de Copernicus que du côté de Galiléo. Chacun a un peu son bébé et chacun veut initier quelque chose. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec une boule qui grossit, qui grossit, parce que chacun ajoute sa petite...
Donc.
[00:34:18] Speaker B: Ça veut dire que quand même, ça reste Copernicus et l'observation de la Terre, ça reste quand même quelque chose de sexy ou pas trop. Tout à l'heure, tu disais que ce n'est pas si populaire que ça finalement.
[00:34:32] Speaker A: Non, parce qu'au niveau des politiques, ce qu'on m'a dit à la commission, c'est qu'ils considèrent que c'est nice to have. C'est bien de la voir, mais que ça pourrait presque être optionnel. Et je pense qu'ils ne savent pas complètement l'influence qu'ils ont avec ce programme et ils ne se rendent pas compte aussi du bruit que ça ferait si on arrêtait, par exemple.
[00:34:54] Speaker B: Oui, moi j'ai l'impression quand même qu'en Europe, la lutte contre la crise climatique par la surveillance de la Terre, c'est quelque chose de compris, d'acquis, de populaire, d'important.
C'est pas ce que tu ressens par rapport à d'autres sujets, je veux dire.
[00:35:17] Speaker A: Si on prend les pays qui sont au comité Copernicus, par exemple.
[00:35:24] Speaker B: C'est lesquels ?
[00:35:24] Speaker A: C'est tous les 27. Plus ceux qui contribuent et qui ne font pas partie de l'UE, comme il y a le Norvège et maintenant il y a le Royaume-Uni aussi. Mais tous tiennent énormément au programme. C'est vraiment viscéral et même, je dirais que c'est un des rares sujets où on est tous d'accord.
Et c'est assez joli à voir, d'ailleurs, parce qu'on se dit que quand on construit quelque chose vraiment ensemble, chacun considère qu'il lui appartient et que le programme lui appartient. Et donc, ils défendent les fondamentaux du programme. Et vraiment, il y a des valeurs sur ce programme.
[00:36:03] Speaker B: Tu vois, c'est marrant que tu dis ça, parce qu'on se pose souvent la question des valeurs européennes. Tous les 5 ans, on se pose des questions, c'est quoi les valeurs de l'Union Européenne ? On se rend compte que sur les valeurs fondamentales, qui touchent presque à l'intime, on n'est pas d'accord, on a des cultures différentes, des pays qui sont plus ou moins plus catholiques, d'autres plus protestants, il y en a qui préfèrent ouvrir les frontières, d'autres les fermer.
Ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a un sujet sur lequel on est tous d'accord, c'est finalement la protection de l'environnement.
[00:36:37] Speaker A: Oui, d'une certaine façon, oui. D'une certaine façon, oui. Quand on s'est mis autour de la table pendant la présidence française pour définir l'avenir de Copernicus, c'était la présidente du conseil et on On a rédigé la France, enfin j'ai rédigé puisque c'était moi en l'occurrence, mais j'ai préparé une proposition pour l'avenir de Copernicus. On a fait un sondage au niveau européen, on a essayé d'intégrer les besoins et les envies de chacun et on a eu aucun mal à faire adopter ces conclusions du Conseil sur Copernicus. Il y avait vraiment une unité de vues et de valeurs qui était assez intéressante et assez jolie à voir, en fait.
[00:37:21] Speaker B: Excuse-moi de creuser un petit peu là-dessus, mais il y a une espèce de paradoxe dans ce que tu expliques finalement. En tout cas, c'est comme ça que je le reçois. D'un côté, il y a des choses beaucoup plus importantes, beaucoup plus fondamentales, peut-être beaucoup plus stratégiques. En tout cas, c'est comme ça que c'est vu.
que Copernicus, qui pourrait presque être optionnel. Et d'un autre côté, tu décris un consensus assez large et facile à obtenir. Je pense pas que ce soit si facile, je pense que tu es assez modeste sur la question. Mais en tout cas, un consensus qui existe. Pour moi, ça m'a l'air paradoxal, je me trompe.
[00:37:59] Speaker A: J'ai pas l'impression que ce soit paradoxal. Je crois que c'est parce que quand on est politique, on est happé par l'actualité, on est happé par les choses immédiates, par l'immédiateté des choses. Mais quand on fait un travail de fond et quand on travaille en lien avec la recherche, en lien avec les organismes, qui ont une vraie valeur scientifique, on se rend compte qu'on travaille sur des questions qui sont beaucoup plus à long terme. Et ce ne sont pas forcément des politiques qui vont défendre les valeurs de Copernicus. C'est des chercheurs. Ce sont des gens comme moi.
[00:38:35] Speaker B: Toi, à la base, justement, tu es ingénieur scientifique ?
[00:38:38] Speaker A: Je suis ingénieure moi. Je suis ingénieure en météorologie à la base, et puis j'ai fait en plus un master spécialisé à l'école centrale en informatique.
[00:38:50] Speaker B: D'accord, t'as vraiment cette culture d'ingénieur à la base.
[00:38:53] Speaker A: Oui, oui, oui.
[00:38:54] Speaker B: Et donc t'as grandi dans ce monde politique finalement au bout d'un moment, c'est ça ?
[00:39:00] Speaker A: Disons que quand on est dans un établissement public comme moi, j'étais au début chez Météo France, tu ne vois pas les interactions avec le monde politique d'un PDG et puis voilà, il dit on fait ci, on fait ça et tout le monde fait... Et puis, j'ai quitté Météo France pour aller au ministère des Transports à l'époque. et travailler sur Galiléo au départ et puis sur la tutelle de Météo France et de l'hygiène. Et puis après Copernicus, quand Copernicus est arrivé. Donc en fait, je l'ai suivi depuis le tout début. En réalité, c'est vraiment un des grands plaisirs que j'ai de l'avoir vu grandir.
en envoyant un traité et puis hop, des satellites. C'est incroyable.
[00:39:45] Speaker B: Mais ça, c'est énorme. Moi qui travaille à l'Agence Spatiale Européenne, j'ai des collègues aussi qui sont dans ce cas-là, qui ont vraiment posé les fondations d'un programme Copernicus qui est aujourd'hui C'est le numéro un mondial, pour prendre un vocabulaire un peu plus populaire. Joseph H. Barher, qui est le directeur général de l'ESA aujourd'hui, faisait partie aussi de cette équipe-là. Je ne sais pas si tu l'as connue.
[00:40:12] Speaker A: Bien sûr. Avant, il était le point d'interface entre l'Agence spatiale européenne et le comité Copernicus. Joseph, il vient de là. Il vient de Copernicus.
[00:40:25] Speaker B: Vous avez une petite bande d'alumni de Copernicus des débuts ? Vous faites des apéros de temps en temps, des choses comme ça ?
[00:40:32] Speaker A: Non, on ne fait pas des apéros. Mais on se connaît bien et donc on sait à qui on peut faire confiance ou non. Et je crois que c'est important pour construire de bonnes relations, à la fois au niveau international et à la fois au niveau européen. Il ne faut pas changer de poste tout le temps. Il faut que les gens identifient que vous avez une parole. Et que quand vous dites, OK, je te soutiendrai là-dessus, mais il faut que tu me soutiennes là, que vous tiendrez votre part du contrat. Et moi, j'ai de très bonnes relations avec plein de gens, alors qu'en France, ce n'est pas forcément le cas. Au niveau national, on dit qu'on a plus ou moins de relations avec tel ou tel pays. Alors que moi, j'arrive à travailler avec tous, en fait.
[00:41:18] Speaker B: Et donc, ce que tu dis, enfin, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que même pour la création de grands programmes qui impliquent des dizaines de pays, littéralement, sur des dizaines d'années, au fond, une composante essentielle, c'est la confiance entre quelques individus qui comptent.
[00:41:38] Speaker A: Oui, je pense, oui. Enfin, pour moi, oui, c'est ma vision. C'est ce que je fais et je pense que si ça s'est bien passé aussi quand on a fait nos conclusions du Conseil, c'est parce que j'avais fait des réunions avec tout le monde. Ce qu'on a fait avec le ministère de la Transition écologique, on a fait un questionnaire pour les utilisateurs et qu'on a eu à cœur de trônette par rapport à ça, c'est-à-dire de restituer ce qu'on nous avait donné. En plus de ce qu'on voulait, mais il n'y avait pas de divergence, en fait. C'est ça qui était agréable à faire. Et ça, ça a été apprécié, je crois. Je crois que ça a été apprécié que les gens retrouvent un peu de ce qu'ils avaient apporté dans le document qu'on leur a proposé, dès la première fois, en fait.
[00:42:24] Speaker B: Et ça, c'est la vraie manière de faire de la construction européenne, au final ?
[00:42:28] Speaker A: Pour moi, oui. Pour moi, oui. Mais c'est vraiment... C'est personnel, je dirais. Je dirais pas que c'est valable pour tout le monde, mais c'est ma façon à moi.
[00:42:41] Speaker B: Non, mais dans ce que j'observe, moi, de ma petite fenêtre, on va dire, C'est assez typique de la construction européenne, des réussites de coopération internationale comme ça. Encore une fois, on est dans une période de l'histoire où tous les jours, on reçoit des messages où il faut y aller tout seul, on n'a pas besoin des autres, on s'isole et c'est comme ça qu'on ira plus vite et que ce sera mieux au final. Toi, c'est quelque chose dont tu doutes, j'ai l'impression.
[00:43:13] Speaker A: Oui, moi, franchement, je ne pense pas qu'on fasse sa construction européenne de son bureau. Je pense qu'on l'a fait en en participant aux réunions et en essayant de comprendre la position des autres. Les autres, ils ne sont pas forcément mal intentionnés. Ils ont une raison. Oui, ils ont une raison de dire ce qu'ils disent et de faire ce qu'ils font. Cette raison, il faut voir si on peut vivre avec ou pas. Il faut la connaître, la comprendre. Mais quand on ne fait pas cet effort-là, on est dans le fantasme, en fait. on s'imagine que. Et le fait de s'imaginer que, c'est dramatique, parce qu'en réalité, il y a beaucoup de malentendus comme ça.
[00:43:51] Speaker B: Quand tu parles de fantasme, tu dirais qu'on se crée une image de l'autre, qui nous arrange, nous, dans un conflit ou alors pour créer un conflit plus facilement ?
[00:44:05] Speaker A: On ne fait pas l'effort. Non, on ne cherche pas à créer un conflit, mais on ne se rend pas compte. On donne un sens qui n'est pas forcément le vrai au comportement des autres. Et puis, je veux dire, il y a un moment, enfin, il ne faut pas mentir.
Si on ment et si on est pris, ce qui est le cas tout le temps en fait, sur la durée, c'est tout le temps, on n'est plus crédible et plus personne ne veut travailler avec nous. Et ça, je crois qu'on n'est pas obligé de tout dire, mais on n'est pas obligé de mentir. Je ne dis pas tout, loin de là, mais ce que je dis, c'est juste. Et quand je m'engage, j'essaie de tenir ma parole le plus possible.
[00:44:51] Speaker B: Pour faire ce travail qui est quand même vraiment particulier, qui est vraiment unique, c'est quoi les qualités humaines qu'il faut, à ton avis ? Parce que tu commences à en parler.
[00:45:04] Speaker A: Probablement un peu d'empathie, je pense. Maintenant, j'ai vu des gens qui sont vraiment des citoyens du monde, c'est-à-dire qui sont bien et confortables et transparents. Oui, avec tout le monde. Et au niveau international, c'est encore pire que, tu vois, au niveau européen. Au niveau européen, on est proches quand même. On dit qu'on est différents, mais on est proches. Quand on se confronte aux Chinois ou aux Américains, on voit qu'entre Européens, on est quand même proches.
[00:45:36] Speaker B: Et ça, ce n'est pas un problème pour votre employeur. Quand tu représentes une position nationale, d'être un peu trop citoyen du monde, ce n'est pas problématique, justement.
[00:45:46] Speaker A: Si tu veux, quand on va représenter l'État français, on a une position à tenir, qui est la position de la France. Et ça, on tient la position de la France, forcément, parce qu'on est là pour ça. Mais on est avant tout là pour représenter la position française. Mais cette position française, on l'a construit aussi en France. On la construit entre nous, on discute et on essaie de partager, de faire partager ce qu'on pense, être bien, être la bonne direction. Et on essaie aussi de ne pas proposer des positions qui nous enverront dans le mur, parce qu'on sait très bien où sont les limites. Quand on connaît les autres, on sait s'ajuster par rapport à leur position et on essaie de trouver le passage.
[00:46:32] Speaker B: C'est là où l'empathie joue tout son rôle, finalement.
[00:46:35] Speaker A: Oui, on peut convaincre, on teste, on va voir les autres, on discute. Mais effectivement, si ça m'est arrivé de devoir tenir des positions auxquelles je n'adhérais absolument pas, mais je les ai tenues parce que c'était mon rôle.
[00:46:49] Speaker B: C'est ce qui s'appelle le professionnalisme.
[00:46:51] Speaker A: Il n'y a pas le choix, sinon on n'est pas... On ne peut pas se dire qu'on représente l'État. Tu vois ?
[00:46:57] Speaker B: Non, je comprends. Tu disais tout à l'heure qu'on se dit très différent entre Européens. Et c'est vrai que pour passer ma vie dans un environnement européen, ça fait partie du quotidien de dire que les Italiens sont comme ci, les Allemands sont comme ça, les Danois, etc. Mais ça fait aussi partie de mon quotidien de travailler avec Des agences comme la NASA, comme Roscosmos, comme la JAXA, les japonais, etc. J'ai l'impression que quand tu travailles avec des non-européens, tu te rends compte à quel point, finalement, on est proche.
[00:47:34] Speaker A: Oui. Je vois à géo, on est vraiment un noyau d'Européens et pourtant, on est avec les Grecs, les Allemands, les Italiens et on est toujours d'accord sur les fondamentaux.
[00:47:51] Speaker B: OK.
[00:47:52] Speaker A: Il y a très peu de différences de position entre nous. Et d'ailleurs, c'est une force, parce que comme c'est l'Union européenne qui représente d'Angéo, c'est un des rares cas où c'est l'UE qui nous représente, en fait. Et nous, on est membre du caucasus de l'Union de l'Europe. Et donc, c'est important qu'on arrive à se mettre d'accord, ne serait-ce que pour soutenir notre vice-présidente, qui est Johanna Drake.
qui est la DGR Teddy Adjoint et qui est vraiment, elle est vraiment très très bien.
[00:48:29] Speaker B: Et, ok, je te pose une question qui m'intéresse parce que j'ai toujours l'impression que nous, les européens, qui travaillons dans un environnement européen, bien sûr, ce qui est ton cas, la coopération internationale, ça fait partie de notre quotidien finalement. Tous les jours, on fait de la coopération internationale, de fait, puisqu'on interagit avec des gens qui ont une langue maternelle différente, une culture différente, etc. Et que le moment où on va voir des Chinois par exemple ou des Russes ou des Américains ou des Japonais, peu importe. Finalement, ça n'est qu'une journée de coopération internationale de plus comme une autre. Alors que pour eux, tout d'un coup, ça les sort de leur zone de confort beaucoup plus fortement, beaucoup plus radicalement. Est-ce que c'est ton impression aussi ou alors...
Ou alors il y a quand même une différence énorme entre le quotidien de la coopération internationale européenne et des efforts de coopération inter-continent, ou en tout cas international, qui sont plus conséquents. Qu'est-ce que ça t'inspire cette différence ?
[00:49:42] Speaker A: Disons qu'au départ, le fait de travailler au niveau de l'Union européenne, on est obligé de s'ajuster sans arrêt aux autres. Et donc, c'est déjà un entraînement qu'on a. C'est un état d'esprit. Mais malgré tout, il y a un choc culturel avec la Chine, avec les États-Unis notamment, qui est vraiment très, très important. Et ça, Et du coup, il faut faire attention parce que ça laisse aussi la place aux non-dits. Il faut vraiment essayer de comprendre. On avait un groupe de travail, là, au Géo, début mai, où il y avait une opposition brutale et frontale entre la Chine et les États-Unis. Et en fait, j'ai découvert qu'en fait, le vice-président chinois s'était froissé parce que les États-Unis avaient fait en douce diffuser un document qu'ils n'auraient pas dû faire diffuser sans l'autorisation du vice-président chinois. Et du coup, ils bloquaient sur tout le reste.
[00:50:39] Speaker B: A cause de ça ?
[00:50:40] Speaker A: A cause de ça.
[00:50:40] Speaker B: Sans le dire ?
[00:50:41] Speaker A: Mais ça, je l'ai su après, en discutant avec le responsable chinois. Et en fait, moi, je suis arrivée à cette réunion parce que je faisais partie de ce groupe de travail, parce que comme la Chine, j'avais une méfiance par rapport à ce que voulaient faire les États-Unis. Et donc, je m'étais inscrite dans ce groupe. Et là, j'arrive, je propose quelque chose et tout le monde dit d'accord.
Bon, on sort de la réunion, l'Australienne vient me remercier, l'Américain vient me remercier, le Chinois vient de me remercier. Alors, j'ai dit, j'ai raté un truc, parce que je ne croyais pas où j'ai réussi un truc. Je ne comprenais pas, tu vois. Et en fait, j'ai appris qu'ils s'étaient vraiment, vraiment frittés à la réunion d'avant, auquel je n'étais pas, et qu'ils étaient ravis d'avoir quelqu'un qui propose une position, quelqu'un de plus neutre, en réalité.
Mais c'est vraiment, c'est beaucoup plus brutal. C'est beaucoup plus que ce qu'on a au niveau européen. Enfin, moi, je trouve. C'est vraiment un affrontement de l'obstruction. Alors qu'il n'y a pas d'enjeu géo, c'est un truc avec un budget de 5 millions d'euros.
[00:51:53] Speaker B: Ok, mais j'ai l'impression qu'effectivement, cet entraînement quotidien devient très utile quand on doit, en tant qu'Européens, participer à la coopération internationale.
[00:52:02] Speaker A: S'ajuster, oui.
[00:52:03] Speaker B: C'est pas quelque chose qu'ont les Américains ou les Chinois, parce qu'au quotidien, ils sont entre eux finalement.
[00:52:10] Speaker A: Oui, certainement.
[00:52:13] Speaker B: Je voudrais te poser un petit peu une question sur ta vision de l'avenir de l'observation de la Terre. On a parlé des défis.
Aujourd'hui, mais comment tu vois l'avenir de la surveillance planétaire, de la surveillance de la Terre et de ce qu'on peut faire pour l'environnement ? Est-ce que tu te projettes à l'horizon de 15 ans, 20 ans ?
[00:52:40] Speaker A: Alors déjà, si tu veux, avec les conclusions du Conseil dont on a parlé tout à l'heure, on a jusqu'en 2035. Donc, on est... Disons que les dix prochaines années, c'est fait. Ensuite, il faudra bien sûr négocier le cadre pluriannuel de l'Union européenne. Ça va commencer cet été. Donc, ça, ça va être une étape importante. Mais c'est pour ça qu'on avait fait ça, c'est pour être prêt. Donc là, c'est prêt. Après, disons que celui-là, ça va être optimisé. D'abord, il faut optimiser les opérations. Parce que là, on est arrivé à un stade où les opérations, elles vont nous coûter 4 milliards d'euros pour le prochain cadre financier pluriannuel. C'est beaucoup trop, en fait. En tout cas, c'est une question d'acceptabilité, tu vois. Je n'aime pas trop ce mot parce que c'est juste con, on peut supporter, tu vois. Ce n'est pas un mot que j'aime.
[00:53:36] Speaker B: C'est une mesure un peu psychologique.
[00:53:37] Speaker A: Oui, je pense que c'est... En même temps, on veut beaucoup d'observations et en même temps, quand on les a, on s'aperçoit que ça coûte cher d'opérer les satellites, évidemment. Donc ça, c'est qu'on trouve un moyen d'optimiser. Et je pense que la suite, il faudra revoir l'architecture. Il faut aussi faire en sorte que la France continue d'investir dans l'agence spatiale européenne et notamment en observation de la Terre, parce qu'on a quand même de l'expertise de premier plan et cette expertise doit être...
C'est difficile la carrière de l'expertise. La perte, par contre, c'est très facile. Ça va très vite. Il suffit de ne pas être là à un rendez-vous et déjà, on est en retard pour dix ans. Ça paraît incroyable, mais pourtant, j'ai pu l'observer plusieurs fois dans ma carrière. Donc ça, c'est un premier défi, c'est d'arriver à financer vraiment les programmes au niveau européen. Et pour Copernicus, il faudra trouver finalement un modèle pour les données complémentaires. On ne pourra pas continuer à faire des sentinelles privatifs, etc. Il faudra trouver peut-être des meilleurs compromis avec l'industrie, faire des constellations hybrides. On avait un projet comme ça à l'Agence Spatiale Européenne pour la prochaine échéance, la prochaine mystérielle, et qu'on a dû abandonner malheureusement parce que tout Tous les pays n'étaient pas d'accord. Ce sont des choses qui arrivent. Mais je pense que c'est une erreur parce qu'on y reviendra probablement.
[00:55:12] Speaker B: Et tu parles d'expertise.
Tous les jours, aujourd'hui, on entend parler de l'IA, de l'intelligence artificielle. J'imagine que quand on parle de prévision, l'intelligence artificielle, ça fait partie des outils qu'on aime utiliser pour affiner ses prévisions. Jusqu'où on peut aller, à ton avis, dans l'utilisation de l'intelligence artificielle pour prévoir les effets du changement climatique ?
[00:55:40] Speaker A: Si tu veux, l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle est déjà partout et elle se nourrit de données. Donc les observations, on ne va pas y toucher. De toute façon, il nous les faut parce que c'est elle la base. Il faut des bases de données propres, etc. L'IA, on l'utilise pour améliorer les parties de modèles, les équations qu'on ne sait pas résoudre, par exemple, pour s'approcher au plus près du bon résultat. Jusqu'à présent, c'était un peu empirique. On tâtonnait, on essayait, on regardait ce qui donnait le moins mauvais résultat. Et là, le Centre européen de prévision météorologique de Reading, il a fait faire des gros progrès à la prévision en utilisant l'IA sur ces parties-là, sur les parties qui sont... On l'utilise aussi pour la descente d'échelle, c'est-à-dire que quand on a un modèle avec une maille qui est assez grosse, on essaie de redescendre et on utilise l'IA pour...
[00:56:35] Speaker B: Pour affiner l'image.
[00:56:36] Speaker A: Voilà, et on le fait pour notamment le changement climatique. Et donc, du coup, si on a des Si on affine les prévisions, on arrive davantage à prévoir ce qui va se passer localement, parce que finalement, l'adaptation, c'est une question locale.
C'est-à-dire, comment... Qu'est-ce qu'on est, nous, en tant que collectivité, en tant que groupe d'humains ? Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour s'adapter ? Parce que parfois, il faut déplacer une ville, il faut déplacer des quartiers. Ça s'est fait. Ça s'est fait dans les pays nordiques, pas à cause du changement climatique, pour des mines qui commençaient à faire effondrer le sol sous le village.
[00:57:16] Speaker B: Oui, d'accord, mais c'est un des bons modèles, finalement, pour le changement climatique, puisque tu parlais tout à l'heure de la montée des eaux. Si il y a un village qui, dans deux mois ou dans six mois ou dans deux ans, si on prévoit que ce sera sous l'eau, il faut déplacer des populations.
[00:57:31] Speaker A: Exactement. Et ce n'est pas facile de dire aux gens, il faut abandonner votre maison. Toute votre histoire familiale, elle est là et il faut partir. Et donc, pour que ce soit acceptable, il faut qu'ils décident eux-mêmes quelque part.
Il faut qu'ils décident eux-mêmes comment ils vont se projeter. Et c'est là que bon, il y a des gens dont c'est le métier de faire du design comme ça, de faire du co-design, d'évolution de société, de territoire. Mais ça, ça ne peut être fait que par les gens qui le font. On ne peut pas arriver de l'extérieur et dire bon, maintenant, vous, hop, vous déménagez. Ça devient... Enfin, c'est violent, c'est brutal. Et puis surtout, je pense que ça ne sera pas accepté. Et c'est normal.
[00:58:11] Speaker B: Oui.
[00:58:12] Speaker A: Tu vois, c'est un sacrifice, il faut le faire en connaissance de cause, il faut le décider.
[00:58:16] Speaker B: Bien sûr. Et en tout cas, la première étape, ce sera toujours de mettre sur la table des données indéniables et improtestables.
[00:58:23] Speaker A: Oui.
[00:58:24] Speaker B: Après, ensuite, la décision que prennent les humains, on peut les regretter ou les saluer, mais au départ, il faut ça.
J'ai entendu parler d'un projet, ou en tout cas d'un concept qui s'appelle Digital Twin Earth, qui serait de créer un jumeau digital de la Terre, justement dans le but de mieux prévoir ce genre de choses, de prévoir les conséquences de certains effets, de pouvoir créer des simulations plus précises, etc. Est-ce qu'on est dans la science-fiction totale ou est-ce que c'est réaliste ?
[00:58:58] Speaker A: Alors, faire un jumeau numérique de la Terre, ça c'est la science fiction encore. Mais par contre, il y a une initiative de l'Union européenne, que je suis aussi, qui s'appelle Destiny, Destination Earth. C'est faire des jumeaux numériques pour anticiper des situations de crise. Et donc là, ils se sont focalisés sur les extrêmes pour la première partie. Et donc, ils ont travaillé avec ECMWF, qui est donc le Centre européen de prévision météorologique à moyen terme.
[00:59:31] Speaker B: Et les extrêmes, c'est quoi ?
[00:59:32] Speaker A: Et les extrêmes, c'est les événements extrêmes. Et là, en l'occurrence, c'est les événements météo extrêmes.
[00:59:38] Speaker B: Donc, excuse-moi, huracan, tsunami, ce genre de choses ?
[00:59:42] Speaker A: Un tsunami, c'est un peu un effet d'un tremblement de terre et là, on n'y est pas. Les prévisions d'un tremblement de terre, on est encore... Enfin, il y a des signes, mais il n'y a pas de prévision. Mais par contre, pour tout ce qui est météorologie, oui. Et donc là, en faisant des modèles, on descend en échelle de façon extrêmement précise, on arrive à identifier des phénomènes qui potentiellement peuvent devenir dangereux. Parce qu'il n'y a pas un système météo, il s'alimente par l'énergie qui vient de l'océan et de la mer essentiellement. Donc plus la température de l'eau de mer augmente, plus on peut alimenter un énergie des phénomènes qui deviennent des phénomènes extrêmes beaucoup plus dangereux que ce qu'ils étaient auparavant.
C'est un effet du changement climatique, cette augmentation d'intensité des phénomènes extrêmes. Et donc la météorologie essaie de prévoir ces phénomènes de façon beaucoup plus précise. Et puis, au niveau local, on va pouvoir faire lancer des simulations derrière ce modèle-là pour avoir l'événement en trois dimensions, etc. Oui, mais ça, c'est déjà... Alors, le problème, c'est que ce n'est pas ouvert. La Commission européenne a décidé au dernier moment de ne pas l'ouvrir puisque c'était une première mondiale et qu'ils voulaient se garder la primeur des données. Mais bon, c'est ouvert pour les météos.
[01:01:18] Speaker B: D'accord, ce sera peut-être ouvert pour les citoyens dans un instant.
[01:01:21] Speaker A: Et ce sera peut-être. C'est difficile d'ouvrir des systèmes comme ça pour les citoyens, parce qu'en France, il y a quand même un modèle. Toutes les citoyens, toute l'information n'est pas diffusée aux citoyens au départ. C'est le préfet qui décide le moment où il diffuse, parce qu'il peut y avoir des conséquences, des mouvements de foule. Et c'est à lui de gérer la sécurité. Et donc, c'est à lui de dire maintenant, il faut annoncer l'alerte. Météo France dit qu'il faut mettre une alerte, mais c'est la préfecture qui diffuse cette alerte.
[01:01:54] Speaker B: Oui, on peut s'imaginer assez facilement que si un groupe d'individus de 300 personnes dans une île comme la Réunion, par exemple, sans que le préfet ait pris la moindre décision ou la moindre mesure, décide de bouger à cause ou de réagir à des données qu'ils ont vues, une prévision qu'ils ont vue, sans que les infrastructures soient mises en place, que les autorités soient prévenues et coordonnées, on peut s'imaginer le genre de conflits que ça peut poser.
[01:02:23] Speaker A: C'est très structuré en France, vraiment. C'est vraiment entre les mains du préfet et qui communique après aux communes, etc. Mais c'est lui le point de départ. Et je crois que c'est très bien que ce soit pris en charge comme ça par l'État, parce que tout est coordonné, les secours sont coordonnés, tout est coordonné. Et je pense que c'est ce qui permet d'avoir la meilleure réaction sur le terrain. Si tout le monde se met à donner son avis, restez chez vous, n'en sortez. On imagine bien ce qui peut se passer.
[01:02:58] Speaker B: Je pense que oui, après la crise du Covid qu'on a vécue, on imagine très bien ce qui peut se passer avec ça. Mais en tout cas, le jumeau numérique de la Terre, on n'est pas dans la science-fiction, c'est ce que tu nous dis. C'est quelque chose qui est déjà en route et vers lequel on tend.
[01:03:15] Speaker A: C'est du domaine de la recherche, voilà. Mais pas de la science-fiction.
[01:03:19] Speaker B: Parfait. Isabelle, tu nous as dit tout à l'heure qu'à la base, tu étais ingénieure et que tu avais commencé dans un domaine de météo. Et je t'ai demandé de nous amener un objet qui symbolise finalement ton attachement au spatial, puisque tu es vraiment dans le domaine spatial aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dévoiler cet objet ou ces objets ?
[01:03:41] Speaker A: Alors déjà, je t'ai amené un petit lanceur.
C'est un lanceur Soyouz. Pourquoi il est spécial pour moi ? C'est parce que c'est lui qui a lancé le premier sentinelle de Copernicus. Et donc j'étais à Kourou, au CST, et j'ai assisté à ce lancement, ce qui est une émotion pour moi. Tu imagines quand tu prépares un programme comme ça depuis son début et qu'il a été lancé en 2014. Le manifeste de Baverno, c'était 1998. Donc tu vois, c'est...
Voilà. Et donc quand Sentinel1 a été lancé sur le lanceur Soyou, c'est un moment vraiment particulier. C'est vraiment... C'était le début de tout. Les services étaient déjà opérationnels, mais voilà, c'était vraiment une... C'était notre bébé, ces Sentinels.
[01:04:31] Speaker B: Et donc tu étais dans la forêt tropicale à Kourou en Guyane française et tu as assisté au lancement de cette fusée depuis le pas de tir à Kourou qui lançait le premier sentinelle. Et donc cette fusée elle est sur ton bureau aujourd'hui ou elle est où alors ?
[01:04:51] Speaker A: Non elle est chez moi, elle est sur mon bureau à la maison.
[01:04:53] Speaker B: Elle est chez toi ? Carrément chez toi à la maison ?
[01:04:55] Speaker A: Oui je l'ai ramenée et c'est vraiment un objet Oui, ça me rappelle ça, et ça me rappelle le chemin parcours aussi, pour Copernicus. Et c'est un vrai bonheur d'avoir moi et d'avoir participé à la construction de ce programme.
[01:05:14] Speaker B: Ça se sent, ça s'entend en tout cas quand tu en parles.
[01:05:18] Speaker A: C'est un programme qui passionne. Je connais beaucoup de gens qui ont travaillé sur d'autres programmes, notamment Galileo, et qui n'ont pas eu la même passion que pour Copernicus.
[01:05:33] Speaker B: Oui, ça se sent vraiment.
[01:05:35] Speaker A: Je suis un peu tombée dedans, comme Obélix dans la potion magique.
[01:05:42] Speaker B: Et tu as un autre, tu m'as amené un livre aussi.
[01:05:44] Speaker A: Oui, j'ai amené ce livre de Jules Verne, Autour de la Lune, parce que Jules Verne, c'est quelqu'un D'abord, c'est hyper réaliste ce qu'il a écrit. C'est vraiment Apollo 8 qu'il a décrit, lancement de Cap Canaveral, une semaine de mission autour de la Lune, etc. Donc, c'est extraordinaire de voir à quel point il était visionnaire. Mais plus que ça, Jules Verne, c'est J'en avais discuté avec un psy pour enfants qui disait qu'il utilisait énormément Jules Verne pour accrocher les enfants à la science. Moi, j'adore tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a écrit, tout ce qu'il a imaginé s'est réalisé. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Je vous invite à faire lire à vos enfants autour de la Lune. Parce que c'est vraiment... mais en fait tous ces livres sont extraordinaires.
[01:06:51] Speaker B: C'est vrai, c'est incroyable même de se poser la question de... est-ce que c'est lui le visionnaire ou est-ce qu'il a été tellement...
comment dire... ou est-ce que ses écrits sont...
tellement fort qu'ils ont eux-mêmes influencé la science ensuite, et les scientifiques, parce que, comme tu le dis, ce sont des récits qui impactent très fort tous ceux qui s'intéressent à la science, et donc c'est facile de se poser cette question d'interaction entre les écrits et puis finalement les gens qui ont développé ces systèmes par la suite.
[01:07:31] Speaker A: Mais moi, je crois vraiment qu'il y a un lien assez fort entre l'art, de façon générale, et la science. Et qu'effectivement, l'art n'a pas de frontières. Enfin, je pense, quand il a écrit ça, c'est pas du tout... Tout était possible pour lui, puisque c'était l'imaginaire. Et du coup, effectivement, comme tu le dis, il est fort possible qu'il ait aussi influencé les gens qui ont fait Apollo 8, certainement.
[01:07:58] Speaker B: Oui, tout à fait.
[01:07:59] Speaker A: Certainement.
[01:08:01] Speaker B: Isabelle, puisque nous sommes dans une émission de Spatial, j'ai quelques petites questions à te poser. Questions rapides. Toi, tu peux prendre le temps pour y répondre si tu veux. Et ces questions, ça commence par le livre. Et c'est quel est ton livre spatial préféré ? Tu peux commencer par celui que tu as amené, si tu veux.
[01:08:21] Speaker A: Oui, mais c'est... Franchement, c'est des livres... Les deux auxquels j'ai pensé, c'est Le Petit Prince, Saint-Exupéry, parce que je trouve ça d'une poésie extraordinaire. Et puis Autour de la Lune de Jules Verne, bien sûr. à lire.
[01:08:37] Speaker B: Et tout le monde a un film spatial préféré chez nous dans le spatial. C'est ton cas aussi, toi ?
[01:08:42] Speaker A: Oui, oui, oui. Moi, le film que j'ai vraiment adoré, c'est Interstellar. C'est un film de Christopher Nolan. Il est extraordinaire parce que d'abord, il traite du sujet qui m'intéresse puisque la Terre est en crise. Il faut trouver des solutions pour survivre. C'est une question de survie de l'humanité. Et donc, ça explore différentes choses. Ils ont trouvé d'ailleurs plusieurs façons de s'en vivre. Ils ont trouvé une planète habitable et ils ont trouvé... Mais j'ai trouvé ce film d'une poésie et d'un... D'abord, il est interprété magnifiquement. Il m'a transportée vraiment.
[01:09:21] Speaker B: Pour le coup, dans Interstellar, pour ceux qui ont vu le film, ils n'ont pas dû bien utiliser les données Copernicus parce que, évidemment, ils n'ont rien fait pour que ça aille mieux sur Terre.
[01:09:32] Speaker A: Oui, mais que fait-on ?
Que fait-on ? Donc, je pense qu'il faut compter sur l'imaginaire de l'homme pour trouver des solutions. C'est parce qu'il faudrait qu'on se mette tous d'accord pour faire quelque chose, mais que visiblement, pour l'instant, il y a un gros continent qui ne fait rien.
[01:09:56] Speaker B: En tout cas, nous, apparemment, on est d'accord et ça, c'est déjà bien.
[01:10:00] Speaker A: C'est pas mal, oui.
[01:10:01] Speaker B: Interstellar, le film préféré de pas mal des invités du podcast. Tu n'es pas toute seule.
[01:10:06] Speaker A: Oui, il est particulièrement magnifique.
[01:10:12] Speaker B: C'est un très, très beau film. Est-ce que tu connais la question moins plus ? Le principe, c'est de savoir si c'était à refaire en gros dans ta carrière, qu'est-ce que tu ferais moins et qu'est-ce que tu voudrais faire plus ?
[01:10:29] Speaker A: Disons que si c'était à refaire, je suivrais davantage le conseil de mon professeur de management des systèmes d'information, qui disait qu'il fallait consacrer 20% de son temps à son employabilité et à sa carrière. Alors que moi, j'ai passé 100% de mon temps à fond dans ce en quoi je croyais et ce que je pensais qui était prioritaire et important. Donc je pense que j'aurais fait ça. Mais c'est pas... Enfin, j'ai pas de regrets. C'est simplement...
[01:11:09] Speaker B: Mais si tu l'avais su, t'aurais fait ça. T'aurais passé plus de temps...
[01:11:11] Speaker A: Je pense que j'aurais dû... Enfin, si j'avais su, j'ai pas d'excuses. On me l'a dit. Je ne l'ai juste pas fait. Oui, tu l'avais fait.
[01:11:16] Speaker B: Donc, tu le redis.
[01:11:18] Speaker A: Voilà.
[01:11:18] Speaker B: Tu le redis à d'autres qui t'écoutent.
[01:11:19] Speaker A: Exactement. Exactement.
[01:11:21] Speaker B: Qui sont libres de suivre ce conseil.
[01:11:23] Speaker A: Exactement.
[01:11:25] Speaker B: Y compris moi, d'ailleurs.
[01:11:26] Speaker A: Il faut y penser. On n'y pense pas assez. Il faut penser à soi.
[01:11:31] Speaker B: Et la chose que tu as apprise dans ta carrière dans le spatial, que tu aurais bien aimé savoir au début, la chose la plus précieuse finalement.
[01:11:42] Speaker A: Certainement, ce que j'ai appris, c'est qu'on ne fait rien tout seul, que c'est illusoire de croire, de s'enfermer dans sa tour d'ivoire et de croire qu'on va tout faire tout seul. On fait beaucoup mieux, on va beaucoup plus loin avec les autres. Et pour ce qui est de l'espatial, l'environnement, tous mes sujets, je pense qu'il faut au moins le minimum, c'est le niveau européen, c'est le minimum. Et donc, il faut arriver à se mettre d'accord avec nos différences, avec nos façons de voir l'Europe différente, avec nos ambitions différentes. Mais on n'a pas d'autre choix en fait, sinon on n'arrivera à rien. Et je trouve que l'Agence spatiale européenne est un très bon exemple de ce qu'on fait ensemble. Et surtout, particulièrement en France, parce qu'on est quand même une agence spatiale qui est extrêmement performante et pertinente. Mais malgré tout, on va encore plus loin, je dirais, au niveau européen. Si on peut, au niveau mondial, c'est encore mieux, mais bon, c'est plus compliqué.
[01:12:43] Speaker B: C'est le mot de la fin, Isabelle. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et merci d'être une de celles qui, sur Terre, font l'espace.
[01:12:52] Speaker A: Merci, Jules.
[01:12:54] Speaker B: Merci d'avoir écouté cet épisode de « Elles font l'espace » en partenariat avec le Commissariat Général au Développement Durable. Cet épisode était produit et réalisé par François Bonnet, Cyril Nobillet et Yann Famoutri. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le partager et à nous mettre plein d'étoiles. Et nous, on se retrouve très vite sur vos plateformes préférées pour un nouvel épisode de « Elles font l'espace ».